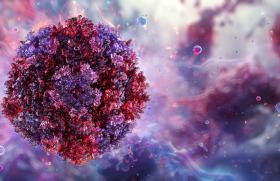Infections, pathologies, maladies dans le cadre de la grossesse
Publié le 11 mar 2025Lecture 4 min
VIH et grossesse : que disent les recommandations de 2024 ?
Laura BOURGAULT, d’après la communication du Dr Isabelle Lamaury (Pointe-à-Pitre)

La contraction du virus du SIDA pendant la grossesse et le suivi des femmes séropositives avant de tomber enceinte nécessite une prise en charge particulière. Que disent les recommandations de 2024 à ce sujet ? Les éclairages du Dr Isabelle Lamaury, médecin infectiologue à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
D’après la communication du Dr Isabelle Lamaury, médecin infectiologue à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), à l’occasion de Gyn Caraïbes organisé du 21 au 24 janvier 2025
Les recommandations de la HAS “Désir d’enfant, soins de la femme enceinte et prévention de la transmission mère-enfant” ont été publiée en mai 2024.
Zoomons dans un premier temps sur les parcours de soins de femmes vivant avec un VIH. “Nous savons tous que l’enjeu principal est la prévention de la transmission mère-enfant qui se fait essentiellement au moment de l’accouchement”, relaie le Dr Isabelle Lamaury. “L’élément essentiel socle de cette prévention contre cette transmission verticale est le traitement anti-rétroviral. Une prévention sous trithérapie initiée pendant la grossesse qui a largement progressé ces dernières années”.
Pour ce qui est de la grossesse, “les cas de VIH sont toujours associés à une grossesse à risque nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et une surveillance attentive à partir du 2ème trimestre, via une surveillance mensuelle sur le plan infectieux et gynéco-obstétrique, incluant les pédiatres et les professionnels du secteur psychosocial. L’objectif étant “de prévenir les conséquences désastreuses de l'infection sur l’enfant dans la phase aiguë mais aussi sur le long terme”, appuie le Dr Lamaury. “Les retentissements des antirétroviraux sont aussi à surveiller.”
Charge virale et césariennes programmées
Pour ce qui est de l’accouchement, “l’enjeu est que la femme soit indétectable au moment de l’accouchement. Si nous sommes dans cette configuration, la prise en charge obstétricale peut être la même que celle déployée pour une femme séronégative”, confirme le Dr Lamaury. “Cette indétectabilité doit être atteinte le plus tôt possible au cours de la grossesse pour que la période d’indétectabilité soit la plus longue possible.”
Quid de l’indication de la césarienne pour prévenir la transmission materno-foetale ? “Dans ces recommandations de la HAS, il n’y a pas de place pour cette indication. Si cette césarienne devait se faire pour des raisons virologiques (si la charge virale n’est pas contrôlée, si la RPM ou le travail sont engagés), elle doit être effectuée à un stade plus avancé, jusqu’à 38 SA. Le risque de prématurité est en effet doublé chez les femmes séropositives comparées aux femmes séronégatives, étaye le Dr Lamaury. Point d'importance dans ces décisions de césariennes programmées, “l’anticipation et la traçabilité des décisions”.
Concernant la perfusion de zidovudine, “les indications se sont encore restreintes en per-partum, avec une limitation à la charge virale. Il n’y a plus d’indication liée à la prématurité ou à des raisons obstétricales”.
Traitement prophylactique systématique chez le nouveau-né
Autre point inclus dans ces recommandations de 2024 : “le maintien systématique du traitement prophylactique du nouveau-né, même dans un scénario optimal, même si la charge virale maternelle est contrôlée”, appuie le Dr Lamaury. En revanche, “le traitement repose sur la viramune, un sirop à raison d’une prise par jour pendant deux semaines”.
Un allaitement envisageable et accompagné
Nouveau point dans les recommandations prises par la HAS : “il peut désormais y avoir un choix concerté sur l’allaitement au sein maternel, alors que jusqu’ici cet allaitement restait fortement déconseillé dans toutes les circonstances. Et si les femmes décidaient de le faire, c’était sans l’aval des équipes médicales”, témoigne le Dr Lamaury. Cette décision a été prise en phase avec le renforcement, grâce à l’allaitement, “du bénéfice relationnel, du lien affectif et de tous les avantages sur le risque infectieux sur le bébé”, et la prévention du cancer chez les femmes.
Dans l’autre versant de la balance, l’allaitement pose la question de la transmission. Mais “l’équation indétectable = intransmissible validée pour les rapports sexuels l’est-elle aussi pour l’allaitement ? A ce sujet, les données sont très disparates, recueillies à des dates et dans des contextes très différents, répond le Dr Lamaury. Reste “qu’au vue des méta-analyses les plus récentes, il existe un risque résiduel qui est de 0,2% par mois d’allaitement, soit un risque cumulé de 2% sur une année d’allaitement au vue des données actuelles, sachant que nous n’avons que très peu de données sur les cohortes optimales de mamans telles que nous les avons définies.”
En conclusion, “l’allaitement dans une situation optimale, s’il est souhaité par la maman bien sûr, peut être envisagé”, affirme le Dr Lamaury. “L’équipe en maternité doit pouvoir assurer une surveillance rapprochée. Pour les nouveau-nés nourris au sein, le traitement PreP doit être poursuivi tout au long de l’allaitement et pendant 2 semaines supplémentaires après la fin de l’allaitement”.
Certaines contraintes doivent par ailleurs pouvoir être anticipées auprès de la maman, “afin d’éclairer son choix” :
un contrôle mensuel de la charge virale pendant 6 mois
“une visite prénatal pédiatrique prévue dans l’idéal, même ce dernier n’est pas toujours évident à tenir étant donné la démographie médicale”
la mesure de l’ARN viral chez l’enfant
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :