Publié le 21 mar 2025Lecture 3 min
Pour une réappropriation de la maternité
Gérard Lambert
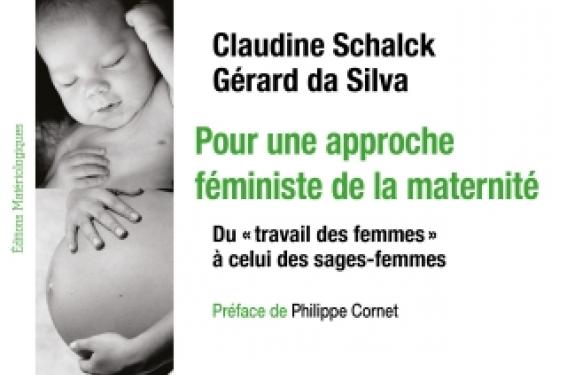
Libérées de l’assujettissement à la fécondité, le corps des femmes serait-il encore en territoire patriarcal au décours de la grossesse et de l’accouchement ? Dans un livre incisif et revigorant Claudine Schalck (sage-femme, psychologue clinicienne) et Gérard da Silva (historien du mouvement social) répondent par l’affirmative, démonstration à l’appui.
L’ouvrage se présente en deux parties. Dans la première, Claudine Schalck s’appuie sur les travaux de François Héritier, Pierre Bourdieu, Michel Foucault ou encore Norbert Hélias, pour montrer en quoi la maternité est assujettie au pouvoir patriarcal, source d’asservissement des corps, d’entraves « au pouvoir d’agir dans la mise au monde », d’obstacle aux désirs de réalisation personnelle et sociale. La spécificité du féminin, souligne-t-elle, repose sur le fonctionnement « normal » du corps des femmes : les menstrues, la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et, par contiguïté, la sexualité.
Sans nier les progrès de la médecine qui ont permis de penser une maternité débarrassée du spectre de la douleur et de la mort, Claudine Schalck constate que cette même médecine continue de placer la grossesse et l’accouchement sous les auspices de la vulnérabilité. Une situation qui ne fait que perpétuer une tradition ancienne, la collection hippocratique abordant ces sujets dans le Traité des maladies des femmes.
Outre le fait qu’il occulte que 80% des grossesses ne sont pas à risque, ce brouillage des frontières entre normal et pathologique n’est pas sans conséquence sur la santé physique et mentale des femmes (« fragilité psychologique ») ainsi que sur leur devenir social (rupture de parcours professionnels). Dans la hiérarchie du travail, il circonscrit les rôles et attributions : le normal pour la sage-femme, le pathologique pour le médecin.
C’est ici que le destin des femmes et celui des sage-femmes se confondent, le travail de l’une prolongeant le travail de l’autre. Car les métiers du soin sont considérés comme des métiers féminins par nature puisqu’ils conjuguent attention, dévouement, sollicitude, « nourrissage », mettant ainsi en valeur les « savoirs faire » acquis dans la sphère domestique. Une fois le tableau brossé et le constat acté, comment ne pas penser dans ce contexte aux violences gynécologiques et obstétricales, aux épisiotomies abusives et à l’augmentation inconsidérée des déclenchements, autant d’interventions souvent non consenties sur un corps-objet ?
Par une approche originale de l’histoire des femmes, Gérard da Silva explique dans la deuxième partie comment, en quelque sorte, on en est arrivé là. Durant des millénaires le corps féminin a été valorisé, et ce dès la préhistoire comme en témoignent les quelques 30 000 statuettes exhumées dans le monde. A partir de l’Antiquité son étude se focalise à l’obstétrique et à la figure de la sage-femme largement représentée dès l’époque pharaonique.
On y apprend que Phénarète, la mère de Socrate, était sage-femme, un modèle et une source d’inspiration pour le père de la maïeutique. Si dans ces temps anciens le corps de la femme n’apparait pas comme impur, contrairement à ce qui surviendra avec l’avènement du monothéisme, le savoir médical ne l’entrevoie qu’en référence à celui de l’homme, le maitre étalon. Au point que Soronos d’Ephèse spécule la présence de testicules dans les entrailles féminines.
Après avoir évoqué la vie et les ouvrages de Louise Bourgeois qui fut accoucheuse de Marie de Médicis, Gérard de Silva retrace, à travers une passionnante étude des traités d’obstétrique depuis le XVIIe siècle, la prise de pouvoir progressive des médecins avec, pour corollaire, la relégation des sage-femmes au second plan. Si la Révolution française s’oriente vers leur reconnaissance en accordant un droit conditionné à l’utilisation du forceps inventé en 1747 par André Levret, la loi de 1892 leur interdit cette pratique en stipulant que « dans le cas d’accouchements laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un office de santé ». Un tournant radical et pour l’heure ans retour, qui inscrit le partage genré des tâches dans la législation.
Au total un livre riche, documenté et référencé avec lequel on peut être en désaccord sur certains points mais qui, dans tous les cas, donne matière à réflexion.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :






